A propos de la libération / persécution de 1945
Le sens de la vie, selon Léon Degrelle
Nous nous sommes fait l’écho naguère de l’appel à témoins lancé par l’hebdomadaire nationaliste flamand ‘t Pallieterke concernant le 75e anniversaire de la « libération » de la Belgique en septembre 1944 (voir ce blog au 6 juillet 2019). Entretemps, les nombreuses et édifiantes réponses reçues de toutes les régions de Flandre ont été publiées dans deux suppléments du magazine, mais sans aucun écho des régions bruxelloise ou wallonne. Et pourtant, nous avions bien envoyé le témoignage d’une famille namuroise littéralement persécutée pour son engagement en faveur de l’Europe d’Ordre nouveau promise par la croisade antibolchevique. Nous le publierons très certainement bientôt.
 Ce qui nous a néanmoins passablement interloqué, c’est la publication d’un portrait charge de Léon Degrelle particulièrement édifiant quant à la réputation qui, dès la fin de la guerre, fut répandue sur le dernier Commandeur de la Légion Wallonie (dessin de Jef Nys, daté de 1946).
Ce qui nous a néanmoins passablement interloqué, c’est la publication d’un portrait charge de Léon Degrelle particulièrement édifiant quant à la réputation qui, dès la fin de la guerre, fut répandue sur le dernier Commandeur de la Légion Wallonie (dessin de Jef Nys, daté de 1946).
On y voit en effet Léon Degrelle en uniforme feldgrau (de la Wehrmacht plutôt que de la SS néanmoins, mais pourvu de sa croix de Chevalier de la croix de fer) prenant plaisir à la compagnie de deux affriolantes jeunes filles, genre vahiné tahitienne, sur une plage où foisonnent palmiers et personnages à sombrero (masculin à longs poncho et moustaches ; féminin à large décolleté et jambe dégarnie), le tout irradié par un soleil interloqué.
Ce qui correspond à la thèse désormais accréditée par tous les pseudo-historiens de la mouvance (désormais seule accréditée) du CEGESOMA, les Collignon, Balace, De Bruyne, Conway, etc. : Léon Degrelle aurait lâchement abandonné ses soldats pour s’enfuir vers l’Espagne (par exemple, dans Axe & Alliés, p. 66, voir ce blog au 28 novembre 2017). Nous avons déjà documenté, par le témoignage notamment de l’officier d’ordonnance du Commandeur, Charles Generet, qu’il n’en était évidemment rien (voir ce blog au 20 juillet 2018), mais cette fable aura la vie dure tant que de jeunes historiens ne secoueront pas le joug du conformisme officiel. Il est symptomatique à cet égard que ce soit une image en tout point semblable à celle du magazine flamand de 1946, innocemment (?) rappelée aujourd’hui, que le mensuel wallon Confluent publia en novembre 1977.
Comme quoi les légendes traversent allègrement les frontières linguistiques… formatant les opinions des « amis » sur celles des « ennemis » !
Le mensuel Confluent de novembre 1977, tel que reproduit en noir et blanc dans Tintin mon copain.
Pour en revenir à la vie de Léon Degrelle en son exil espagnol, nous ne ferons que renvoyer nos lecteurs à ce blog au 28 mai 2016.
Plus important néanmoins est de cerner la philosophie de vie de l’ancien tribun de REX, ancien Commandeur de la Légion Wallonie et désormais proscrit en Espagne. Pour ce faire, nous avons retrouvé cette importante lettre écrite à la veille de l’an 1975 à sa fille Chantal.
Chantal est sa fille aînée, née le 13 février 1934, dont l’œsophage fut brûlé, à deux ans, par de la soude caustique ingérée accidentellement. Elle vivra pendant plusieurs années entre la vie et la mort, soignée par les meilleurs spécialistes de Bruxelles et de Paris.
C’est à elle que Léon Degrelle écrit à la fin de 1974, lassé d’une longue séparation, lui donnant des nouvelles pittoresques de ses accidents de santé, mais surtout lui délivrant un magnifique message sur le sens qu’il donne à une vie réussie, pleine de beauté, de bonté, de joie, de don, de Dieu…
Nous sommes bien loin des crachats de tous ceux qui, ne voulant jamais rien comprendre à rien, ne peuvent que salir ce qu’ils approchent !
Le 29 décembre 1974.
Ma petite Chantal chérie,
Mais oui, mais oui, tout arrive. Ton papa est là, sur le pas de ta porte, te souriant tendrement et t’aimant. J’ai mis le temps ? ça, c’est vrai ! C’est impardonnable ? vrai encore ! On n’imagine pas des pères pareils ? ce que tu as raison !
Moi qui étais si actif, si infatigable, abattant le travail et l’obstacle dix-huit heures sur vingt-quatre, suis capable de rester engourdi pendant des mois, comme un loir ou comme une marmotte ! Tous les jours, je te répète de loin que mon cœur est près de toi ; chaque nuit, je m’enguirlande d’avoir encore passé un jour de plus sans t’écrire, je me jure de me mettre devant une feuille de papier blanc dès l’aube, et puis, patatras ! je me laisse accrocher par un bouquin, dévore trois cents, quatre cents, cinq cents pages, annote, compare, recherche, puis je subis la visite de dix raseurs et me retrouve, à la nuit, furieux de ne pas t’avoir écrit encore !
Et puis, tu sais, j’ai collectionné les complications, comme jadis les timbres-poste ! Je suis incapable de rester six mois sans jouer un tour de pendard à mes ennemis. Ou c’est une déclaration à un grand journal qui leur éclate dans les pattes comme un pain de plastic. Ou c’est une heure d’interview à la télévision hollandaise, quelque chose de carabiné, que toute la Belgique écoute, ravie de la bonne blague, mais qui provoque une demi-douzaine de cas d’apoplexies (résultat très apprécié) parmi les grosses légumes qui voulaient ma peau.
C’est le 12 mars 1973 qu’à la stupéfaction générale, la télévision néerlandaise diffusa la toute première interview de Léon Degrelle. Mais en 1971, le livre-interview de Wim Dannau, Degrelle, Face à face avec le rexisme avait également fait grand bruit. En 1973 encore, le même auteur provoqua à nouveau le scandale en proposant en souscription l’édition en treize volumes de Ainsi parla Léon Degrelle, tout en annonçant avec fracas le retour de Léon Degrelle en Belgique pour décembre 1974. Le 17 juin 1974, le journal officiel belge s’empressa de publier la fameuse Lex Degrelliana prolongeant de dix ans le délai de prescription de la condamnation du 27 décembre 1944 !
Alors, les survivants ne sont pas du tout contents, ils font du chahut près du gouvernement espagnol, exigent qu’ils collent une muselière à mon museau. Ça m’amuse beaucoup, chaque fois, mais, n’empêche, il me faut alors, plonger pendant quelques mois, en remorquant d’énormes valises de bouquins, en vivant de boîtes de sardines et de pommes de terre à l’eau ! Mais je ne capitulerai jamais. J’ai eu raison et je le répéterai, d’une voix de stentor, jusqu’à la fin. Et la fin n’est pas pour bientôt. J’ai déjà en tête l’interview que je donnerai, dans une conférence de presse, le 1er janvier de l’an 2000. Tu verras, je serai encore alors tout gaillard ! En attendant, ceux qui brûlaient tellement de me voir mort claquent tous, la mâchoire de travers, l’un après l’autre. Van Zeeland, l’ancien Premier ministre belge, que j’avais envoyé jadis cul-par-dessus-tête ? Enterré ! Pierlot, notre ennemi de Londres ? Quelques os, aussi lisses à présent que ne l’était jadis son crâne verni comme une casserole émaillée ! Et le gros Spaak ! cette bedaine énorme et flasque plantée sur des jambes petites comme des quilles ? Ramené dare-dare à Bruxelles dans un avion de l’armée américaine, suant, soufflant, faisant eau de toutes parts, attrapé par le fond de la culotte par le diable après deux jours d’agonie ! Tous claqués ! Et moi bien tanné par le soleil, heureux de vivre, éclatant de bonne humeur au bord des tombes de mes candidats-fossoyeurs ! J’y passerai un jour à mon tour ? Possible. On verra bien. Ce n’est pas si sûr que cela. Pourquoi faudrait-il vraiment mourir ? Je n’en ai aucune envie. J’éclate de dynamisme. La vie est un enchantement. Vivre ! Voir le ciel éclatant de l’or de l’aube ! Vivre, respirer à grands coups l’air puissant du large ! Vivre ! Sentir que le cerveau saisit tout, crée de l’original, du beau, du grand ! Vivre ! Sentir qu’on est une parcelle de l’immense puissance solaire, nourricière, éblouissante, tournoyante comme un tableau de Van Gogh ! Vivre ! être une des étoiles humaines que Dieu a jetées sur les sols les plus divers, à travers les espaces ! Mais c’est un enchantement, vivre ! C’est une conquête, un épanouissement de chaque seconde ! Comment perdrait-on une minute de cette fête, la laisserait-on s’arrêter une minute trop tôt ?
 Alors, les peines, les labeurs harassants, les catastrophes ont pu m’accabler, la foi dans la vie gronde toujours en moi, souveraine !
Alors, les peines, les labeurs harassants, les catastrophes ont pu m’accabler, la foi dans la vie gronde toujours en moi, souveraine !
Ai-je vieilli ? Bien sûr, mais je me le nie à moi-même. Les accrocs, pourtant, ne m’ont pas manqué.
D’abord, je me suis flanqué (de dix mètres de hauteur !) du sommet d’un vieux chêne. Ecoute-moi ça !
J’avais dû, voilà deux ans, chercher refuge dans une propriété non loin de grandes montagnes, qu’un officier supérieur avait mise à ma disposition (on me traquait de nouveau). Bon. Je vivais là tout seul, avec mes bouquins (c’est-à-dire avec cent interlocuteurs passionnants). Trois fois par semaine, une camionnette passait à cent mètres de mon refuge, sur une petite route campagnarde, trimballant des tomates, des patates, des salades, des savonnettes, pour les rares habitants de la région. Je cuisais mes patates à l’eau, confectionnait une énorme platée de salade à laquelle je me servais quand j’avais faim. Complication ? Aucune. J’écoutais les abeilles, les moineaux et mes grandes voix intérieures. Parfait, donc. Mais voilà ! Le soir, je voyais le soleil couchant se diluer au-dessus des arbres de ma chênaie. Je me disais : du haut de ces arbres, on doit pouvoir contempler le formidable déploiement des ors, des violets, des verts pâles du crépuscule entre les versants des montagnes, que la végétation puissante me cachait. Pour m’en enchanter, il n’y avait d’autre moyen que de grimper au sommet (« al copette » comme on dit en wallon) du plus grand de mes chênes-verts. Je me hissai donc. J’arrivai tout en haut. C’était prodigieux. La chaîne entière des grands monts du Guadarrama était comme en feu, mais un feu où mille gerbes géantes d’orchidées, de glaïeuls, de lilas éclataient parmi d’immenses soirées. J’étais tellement transporté, soulevé par l’émerveillement que mes pieds, vulgaires crochets matériels, s’évadèrent de mon subconscient… Et avec la vitesse d’une otarie crevant la surface de l’eau, je crevai l’abondant feuillage ! Patatras ! J’avais rebondi comme un sac de pommes de terre sur le sol. J’avais le pied gauche cassé et le genou droit démis ! Plus possible d’avancer d’un quart de mètre ! Et, à part les écureuils rigolards décortiquant leurs glands et les mulots frottant dans l’herbette leurs petits museaux pleurnichards, pas un être humain à des kilomètres à la ronde ! Je passai donc la nuit au pied de mon arbre, très sensible au charme de l’ombre, à ses bruits furtifs, ses parfums, mais aussi à la sacrée douleur qui me rongeait les deux pattes.
Ce n’est que le lendemain, vers midi, qu’un garde-forestier, après m’avoir pris pour un braconnier, me vint en aide, me porta vers un vieux divan. Aller chez un médecin ? Impensable ! Je ne pouvais être repéré par personne. Je me serrai donc le pied dans un bandage et, malgré le genou cagneux, grâce à une chaise, je me déplaçais de deux ou trois mètres chaque jour, histoire de me servir ma potée de salade immuable, patates, tomates, salade, arrosée de mayonnaise extraite d’un grand pot, jaunissant (la mayonnaise !) au fur et à mesure que le temps passait. Mais l’os se recollait. L’automne arrivait. On vint me repêcher. Mon genou craquette encore quand je me retourne dans le plumard. Misère sans importance. L’incident était clos.
L’hiver dernier, autre alerte ! Un de mes officiers me reconduisit dare-dare au même refuge désert. Il n’y avait qu’une vieille cheminée à feu de bois. Très pratiques, les feux de bois ! Mais celui-ci ne marchait pas, envoyait partout de grosses volutes d’un gris larmoyant. Je toussais. Mon guide était reparti, le feu trouva lui aussi que le temps était venu de disparaître. Il s’éteignit, ne me laissant que la compagnie d’un froid de canard. Car là-bas, l’hiver, il fait des 10°, des 15° sous zéro. Je claquais des dents. J’avais ramassé, pour me couvrir, toutes les loques de ce refuge d’été. Rien à faire. Je me sentais envahi par une fièvre carabinée, puis mordu par une douleur cuisante dans le dos. Quand mon homme réapparut, deux jours plus tard, je lui dis de me conduire dare-dare à une clinique. Mais où ne me reconnaîtrait-on pas ? Je jouai le tout pour le tout : la clinique de Franco ! J’avais une broncho-pneumonie, 40° de fièvre. Mes filles bienaimées m’apportèrent le charme de leurs visites. Drôles d’ailleurs.
Un matin, Anne me racontait des histoires pittoresques depuis une demi-heure. La porte s’ouvre : Servando !
– « Tiens, toi ! » Et se retournant vers moi :
– « Je ne l’avais plus vu depuis hier à midi ! »
Il ribouldinguait avec un copain politique et il retrouvait sa femme au pied de ma couche ! Ils repartirent tous les deux, bras dessus-bras dessous, très amusés de leur aventure !
Il m’a fallu réapparaître une deuxième fois à cette clinique. En changeant de refuge à Madrid, une nuit, à une heure du matin, traînant deux énormes valises de bouquins qui pesaient autant qu’une cuve nucléaire, j’avais senti tout d’un coup une grande douleur, et comme une pomme qui me jaillissait au bas-ventre : je m’étais fait une hernie !
Cette fois-là, il fallait m’opérer. On me réintroduisit à la même clinique de Franco, comme étant… un colonel espagnol. Le lendemain, on me conduisit en charriot à la salle d’opération. Au moment de se mettre à me charcuter, le toubib me demande : « Votre nom, quel est-il déjà ? » Zut et zut ! j’avais oublié le nom de ce colonel ! L’opéré ne savait plus comment il s’appelait ! Drôle d’histoire tout de même ! Je fis comme si le somnifère m’emmenait déjà dans les réserves d’un marchand de pommes (on tombe dans les pommes !)… Le toubib hocha la tête, commença à me cisailler. Tchic, tchic ! c’est inattendu comme bruit ! Mais ce qui fut encore plus inattendu, ce fut l’aventure de Servando. Car Servando était là, gentil et pétillant comme d’habitude, avec Anne et Mme Brevet à ses côtés, attendant, tout près, que mon charriot réapparût. Il tardait. Une heure ! Une heure et demie ! Rien ! Finalement, mon Servando, extrêmement énervé, se décide à descendre trois étages plus bas, à l’entrée de la salle d’opération. Il happe au vol un infirmier :
– « Le numéro un tel ? Comment va-t-il ? »
– « Muy mal ! » (Très mal !), lui répond l’autre. « C’est un cancer. Il a fallu tout ouvrir jusqu’ici. » Et il montrait l’extrémité de l’épaule !
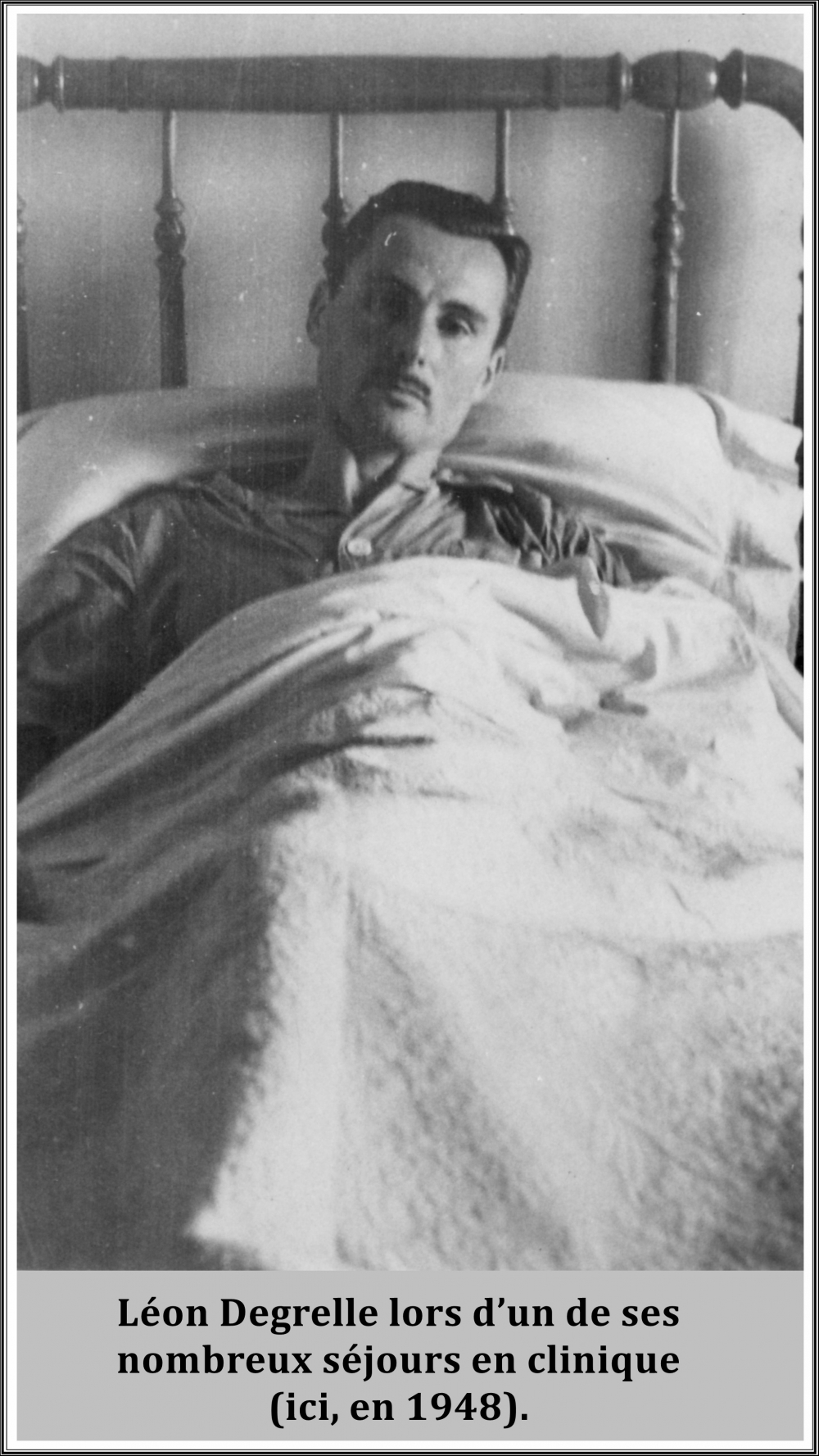 Ça faisait quand même un peu loin pour une opération de hernie ! Le brave type s’était simplement trompé de numéro d’opéré ! Là-bas, on vous éventre à la chaîne, comme un ouvrier de Renault place ses culbuteurs de moteur !
Ça faisait quand même un peu loin pour une opération de hernie ! Le brave type s’était simplement trompé de numéro d’opéré ! Là-bas, on vous éventre à la chaîne, comme un ouvrier de Renault place ses culbuteurs de moteur !
Servando remonta consterné. Il n’osait rien dire à Anne. Gris de couleur ! Enfin, on entend l’ascenseur qui monte. La porte automatique s’ouvre. Un charriot d’opéré apparaît. Vide ! Ça y était ! J’avais claqué !
Heureusement, deux minutes après, autre ascenseur ! C’était moi, recousu, l’œil qui tournait encore ! Le charriot vide, c’était l’autre numéro (le mauvais numéro ! tu parles !). On a rigolé un sacré coup. Mais l’autre était mort tout de même et rigolait beaucoup mois…
Tu vois, la vie = comédies, tragédies ! Et il faut rester en équilibre, jusqu’au bout, sur la corde du Destin !
16 janvier. Pauvre petite Chantal ! Je t’avais de nouveau laissée en plan. Un avion charter plein d’anciens officiers et soldats de ma Division du Front de l’Est est brusquement arrivé pour passer le Nouvel-An avec moi. Déjà, l’an dernier, j’avais vu surgir une irruption identique, mais cette fois-là, accompagnée de… Louise, ma digne Sœur qui avait tenu le crachoir pendant huit jours, me faisant une sacrée concurrence !
Ceux-ci étaient flanqués de leurs femmes et filles, bref beaucoup d’animation ! Et que faire ? Eux s’amènent ainsi en quasi-pèlerinage ! Je dois donc bien alors leur consacrer à peu près tout mon temps. Ce fut, d’ailleurs, parfois très agréable. Nous avons eu des réveillons échelonnés au restaurant, réservé pour nous seuls par un autre de mes officiers, installé à Marbella. J’ai dansé chaque nuit, comme à vingt ans, jusqu’à 3h du matin, sans rater un numéro ! Tu vois, ton père n’est pas encore un vieux père « Rabobostatan » comme on disait à Bouillon.
Pourtant, si je t’ai dit que j’étais physiquement en bonne forme, j’ai quand même, de temps en temps, un accroc sérieux. J’ai encaissé l’an dernier, non seulement une double pneumonie, mais une phlébite. Les professeurs de l’Université de Madrid, venus en aréopage, m’avaient annoncé qu’une opération serait nécessaire dès que je pourrais me lever, c’est-à-dire après un mois. Tu sais, dans la famille, on a eu souvent des varices et j’avais, à la jambe droite, une espèce de gros ver violet qui me montait jusqu’à mi-cuisse, me peinturlurant le mollet et la jambe de tâches noirâtres. Spectacle pas très joli et assez inquiétant. Mais avant d’être ramené de la mer à Madrid, le petit médecin local m’avait indiqué une recette d’un ingrédient de grand-mère, dont il disait grand bien. En attendant donc l’opération, je me barbouillais chaque jour, à toutes fins utiles, de cette pommade bizarre. Et que se passa-t-il ? En deux semaine, le gros ver violet, les taches noirâtres, tout avait disparu ! Le mollet était revenu net comme celui de Diane Chasseresse ! et il n’y avait plus rien à opérer du tout. Un vrai miracle !
En avril 1944, la petite Chantal est guérie : elle profite de la visite de son papa au Mur de l’Atlantique pour prendre l’air de la mer avec son frère et ses sœurs.
Comme Louise, elle, a des varices imposantes comme les vieux barbelés de la Ligne Maginot, j’allai, pour pouvoir lui signaler cette recette extraordinaire, digne de la potion d’Astérix, retrouver mon vieux toubib au « pueblo ».
– « Je vous félicite, lui dis-je. Votre recette a liquidé ma phlébite. Mais je n’ai plus votre bout de papier. Pourriez-vous me redonner la formule ? » Mais ledit médecin de Fuengirola est tout vieux.
– « Ah, me répondit-il, je suis bien content. Mais cette formule ? Je n’en ai plus aucune idée ! »
Il l’avait totalement oubliée ! Et c’est ainsi que la pauvre Louise restera agrémentée de son réseau bleu, pareil à un échantillonnage des pneus Michelin.
J’ai eu une alerte d’un autre genre et aussi embêtante : diabète. Ma grand-mère maternelle est morte de ça. Mais j’ai suivi pendant un mois un régime : verdures, fruits, pas de bière. En fait, je vis sobrement. Et le diabète a duré le temps d’une lune et a disparu.
Total : ça va. Jusqu’à quand ? Autre affaire. J’en ai vu tout de même de toutes les couleurs pendant ma vie : travaux politiques harassants, une guerre terrible, une persécution incessante en exil. Mais la vérité, c’est que tous les gens de mon âge sont « racrapotés » et que je me promène droit comme un pin plein de sève. Je travaille à une grande œuvre historique. Je n’ai jamais un mal de tête. J’abats mes dix kilomètres à pied chaque jour. Je suis joyeux (et Dieu sait si les motifs ne m’ont pas manqué d’être triste !). Et surtout, je vis possédé par la passion du Beau ; et le trouver, le posséder, le créer, me donne des joies indicibles, sources nourricières de mon existence. J’ai maintenant une extraordinaire collection de poteries, de vases, de verres et de bronzes romains. J’ai converti l’appartement où je vis à Madrid (500 m² d’édification et de grandes terrasses, tout en haut d’un immeuble) en un musée, un centre de Beauté qui est mon enchantement quotidien. Et en face, toute la ville étalée, brillante, la nui, de milliers d’étoiles terrestres.
 Tout le nord n’est qu’un déploiement de la chaîne de montagnes du Guadarrama, aux crêtes étincelantes de neige, pendant huit mois sur douze. Ce matin, sous le soleil et le ciel bleu cru, c’est une féérie, que je contemple en t’écrivant. A mes terrasses (50 mètres de long où me promener et où j’ai même des petits pins), mes tulipes commencent à percer. La vie courante de tout le monde est souvent embêtante, lassante, bête, mais elle peut être belle aussi ; et le bonheur, on le porte en soi, on le recrée sans cesse, on le projette. C’est comme les feux d’artifices, ils peuvent n’âtre que de stupides baguettes dans les caisses d’un artificier, ils peuvent aussi remplir le ciel de leurs éblouissantes floralies. Même en fermant les yeux on découvre des couleurs brillantes. La beauté et le bonheur, partout, sont à notre portée, dans la contemplation d’un brin d’herbe, comme dans l’élan mystérieux d’un regard. Tout est à nous. Nous pouvons tout. Mais voilà, il ne faut pas être seulement une petite fourmi qui trottine stupidement et utilement. S’il y a des fourmis, des millions de fourmis, il y a aussi des lions, quelques lions, des aigles, quelques aigles. Il faut être lion. Il faut être aigle.
Tout le nord n’est qu’un déploiement de la chaîne de montagnes du Guadarrama, aux crêtes étincelantes de neige, pendant huit mois sur douze. Ce matin, sous le soleil et le ciel bleu cru, c’est une féérie, que je contemple en t’écrivant. A mes terrasses (50 mètres de long où me promener et où j’ai même des petits pins), mes tulipes commencent à percer. La vie courante de tout le monde est souvent embêtante, lassante, bête, mais elle peut être belle aussi ; et le bonheur, on le porte en soi, on le recrée sans cesse, on le projette. C’est comme les feux d’artifices, ils peuvent n’âtre que de stupides baguettes dans les caisses d’un artificier, ils peuvent aussi remplir le ciel de leurs éblouissantes floralies. Même en fermant les yeux on découvre des couleurs brillantes. La beauté et le bonheur, partout, sont à notre portée, dans la contemplation d’un brin d’herbe, comme dans l’élan mystérieux d’un regard. Tout est à nous. Nous pouvons tout. Mais voilà, il ne faut pas être seulement une petite fourmi qui trottine stupidement et utilement. S’il y a des fourmis, des millions de fourmis, il y a aussi des lions, quelques lions, des aigles, quelques aigles. Il faut être lion. Il faut être aigle.
Mais je suis à la page 10 et je ne t’ai pas encore parlé de toi, de tes belles grandes filles que je voudrais bien tenir, tout de même, affectueusement dans mes bras. Toi ! ma petite Chantal chérie, si tendrement aimée, si douloureusement, pendant tant d’années ! Il n’y a pas un jour où je ne pense à toi, où je ne me souviens de ton long calvaire, qui fut aussi le nôtre, et si cruel, à ta petite maman et à moi. Je me vois encore, à 2 heures du matin, tout seul dans la nuit, sous la petite fenêtre, éclairée par une veilleuse, de la chambre où on te soignait à la clinique de Bruxelles, récitant désespérément mon chapelet pour que tu survives. Sache, Chérie, que maintenant encore, chaque nuit, absolument chaque nuit, je prie pour toi avant de m’endormir. J’ai mes petites habitudes, tout mon rouleau de prières que je récite jusqu’au moment même où je m’endors ; mes dernières pensées, chaque soir, pour Dieu et pour vous ; c’est ainsi ; et au fond, toute ma nature fut toujours ainsi, intensément humaine, puissante, dionysiaque, mais aussi profondément mystiques.
Pendant ces années où la mort te guettait, au moment même où j’étais au sommet de ma puissance et de mes possibilités de domination, ton frêle petit corps blessé était toute ma palpitation intérieure. Tu m’accompagnais sur toutes les routes. Chaque instant où je pouvais m’arracher à mon immense labeur, c’était pour courir à pied, le soir, prier la Vierge de Hal ; c’était pour faire un aller et retour, nuit et jour, Bruxelles-Pyrénées, Pyrénées-Bruxelles, supplier la Vierge de Lourdes de te sauver. Et à Paris (que de courses de Bruxelles à Paris !) quand, en essayant de t’ouvrir à nouveau la voie de l’œsophage, on te creva la poumon, que des bulles d’air jaillissaient partout sous ta peau, que tu étais perdue, je me vois encore, ne pouvant plus rien attendre des hommes, me jeter sur la route de Lisieux : 154 kilomètres (si je ne me trompe pas) à pied, 154 km, flanqué de deux flics parisiens qui, au bout de 50 km, abandonnèrent, dans un champ de pommes de terres où je m’étais affalé pour reprendre un peu de forces !
Désormais une petite fille espiègle comme les autres, Chantal bondit sur le char de son papa au défilé de la Légion à Bruxelles fêtant la percée de Tcherkassy (1er avril 1944).
Jamais, je n’aurais pu croire qu’un corps humain pourrait avoir assez d’énergie pour faire 154 kilomètres ainsi, sans une heure dans un lit. Quand trois jours après, je réapparus de Lisieux, je te vois encore, sauvée, t’intéressant plus à mes jambes (je n’étais plus capable de faire un pas dans ta petite chambre de la clinique parisienne), qu’à ton propre sort ! Tu étais si gentille ! Tu as toujours été si gentille ! Et c’est une grande souffrance, dans mon exil, après avoir été si tendrement unis, unis par un tel calvaire, de ne pouvoir jamais t’avoir un instant contre mon cœur…
Mais ta vie ? Anne, Cri-Cri, parfois me racontent ton train-train quotidien et aussi l’épanouissement apostolique de ton existence. Il faut sortir du médiocre, essayer à tout prix de lui échapper, à lui qui, sinon, vous envahit de toutes parts et vous étrangle comme les ramifications d’un cancer. Et, au fond, la plus noble évasion, celle, en tout cas, qui console de tout, c’est Dieu. J’ai du bonheur à savoir que ta vie en est imprégnée. Tu sais, à la vérité, ce fut mon vrai grand idéal. J’eusse voulu n’être que cela. Cela m’intéressait beaucoup plus que la politique. Je ne sais si tu as le petit bouquin « Les âmes qui brûlent » où j’évoque tout cela. Tu es la seule à prolonger ce qui fut mon grand rêve. Mais ce n’est pas simple aujourd’hui. L’Église, comme tout le reste, est tourneboulée. Mais le cœur des hommes est resté le même, sera toujours le même, et les conforts, les tentations, les aberrations du dehors n’étoufferont jamais les grands appels intérieurs de tout être, sa soif de vérité, de justice, son besoin de se donner et, surtout, son espérance d’éternité. Sinon, vivre, qu’est-ce ? Si ce n’est que tourner en rond pendant 50 ou 80 ans, entre des casseroles ou des manteaux de vison ! Avec des tas de rancœurs, de déceptions, de chagrins, qui, tôt ou tard, vous rongent la poitrine, comme si des hordes de rats nous rongeaient sous nos vêtements ?
 Le bonheur, c’est la paix de l’âme, ce n’est rien d’autre. C’est avoir une âme qui croit et se donne, qui se nourrit des grandes lumières intérieures qui l’illuminent, et se réconforte de la joie qu’elle apporte à ceux qui s’effondreraient non seulement dans les complications matérielles mais dans les longues ombres intérieures de la stérilité spirituelle.
Le bonheur, c’est la paix de l’âme, ce n’est rien d’autre. C’est avoir une âme qui croit et se donne, qui se nourrit des grandes lumières intérieures qui l’illuminent, et se réconforte de la joie qu’elle apporte à ceux qui s’effondreraient non seulement dans les complications matérielles mais dans les longues ombres intérieures de la stérilité spirituelle.
En réalité, l’immense majorité des hommes sont très malheureux, même s’ils ont l’air de ne pas l’être, même s’ils affirment qu’ils ne le sont pas, même s’ils s’agitent, s’ébrouent, dans le tapage extérieur d’une joie qui, presque tout le temps, n’est qu’une apparence ou un faux-fuyant.
Alors, ma grande Chérie, si tu as dépassé le barrage artificiel de la fausse joie criarde d’un monde qui n’est qu’une brillante poussière compressée qui, tôt ou tard, se décomposera, tu as atteint l’essentiel. La seule chose qui ne ment pas, qui ne déçoit jamais, c’est la grande paix intérieure, c’est la vocation secrète qui surpasse tout. Avoir découvert cette vocation, lui avoir permis de jaillir (il y a tant de sources merveilleuses qui jamais ne jaillissent), avoir fait de la vie, pauvre en soi (même si les oripeaux les plus brillants la camouflent) une richesse toujours renouvelée. La vie normale, c’est la pluie. La vraie vie, c’est la mer, toujours là, toujours puissante, éternelle. De l’eau, les deux fois. L’une, une eau banale qui lasse. L’autre, une eau qui vivra, puissante, avec son rythme immense, toujours aussi belle, jusqu’à la fin des temps.
Et tes filles ? Quel problème, des filles ! Quel est le père, quelle est la mère qui y comprennent quelque chose ? Y comprennent-elles quelque chose elles-mêmes ? Un garçon, ce n’est pas simple déjà. Mais cela a, tout de même, quelque chose de plus robustement élémentaire. La fille, ça a la vibration, les mille feux, mais aussi le va-et-vient dansant du papillon. Ce sont des nerfs. Ce sont mille désirs secrets. Et les mille semi-mensonges à elles-mêmes et aux autres, d’êtres qui ne veulent pas se reconnaître faibles, mais qui, en certains aspects, les plus mystérieux, le sont. Corinne, 16 ans ! Je voudrais regarder au fond de ses yeux, essayer de savoir ce qui s’y passe. Mais ça l’embêterait sans doute. Ou au moins, ça la gênerait. Personne n’aime être observé, ni même s’analyser. On aime mieux flotter dans le vague. Au fond, seul le temps impose l’analyse à laquelle, naturellement, on se refuse parce qu’elle pourrait encombrer. Expliquer, essayer de diriger, et surtout donner des leçons, ne sert à rien. Chacun entend bien tout savoir sur son cas, en tout cas beaucoup mieux que les autres ! Personne n’apprend rien à personne. Chacun n’apprend –trop tard souvent– que par les expériences qu’il fait et entend faire seul, expériences catastrophiques, la plupart du temps. Ce n’est qu’après s’être cassé le nez qu’on apprend qu’on en a un ! Que de nez cabossés ou défoncés à jamais par les expériences de l’existence ! On les rafistole parfois par des interventions « esthétiques », on les étire, on les rétrécit, mais le pauvre nez a été amoché, tout de même, à jamais ! Ainsi va l’histoire du bonheur-malheur de l’humanité qui, d’ailleurs, s’adapte, pour finir, se dilue en médiocrité, sorte d’accommodement de l’immense majorité des gens. Car autour de soi, que de gens médiocres ! Mais qui finissent pas être satisfaits –ou inconscients– de leur semi-médiocrité, s’y sont habitués, ne pensent même plus à rien au-delà de ce vague conformisme qu’agrémentent tout de même une auto (comme tout le monde !), une télé (comme tout le monde !), des vacances (comme tout le monde !) et un certain gentlemen-agreement qui fait qu’on ne s’enguirlande plus en famille ou au sein du couple tassé sur lui-même, sur le tard.
« Le bonheur, c’est la paix de l’âme, ce n’est rien d’autre. »
Ce n’est pas rigolo de décrire ainsi la vie (celle de quatre-vingt-dix pour cent des gens ! à mes jolies petites-filles ! Elles ne croiront probablement pas un mot de ce que je viens de dire. Et ce sera très bien. Il faut avoir beaucoup d’illusions, croire que tout sera magnifique. Et d’ailleurs, de temps en temps, ce l’est ! Que ce soit leur cas ! Et puis, il y a aussi la chance, les fluides et même Dieu, dont on ne parle plus guère, qui passe lui aussi pour un vieux radoteur, mais qui est le maître pourtant et nous attend tous au virage !
J’écris une autre lettre à Roland. Tu sais, je l’aime bien, je l’estime beaucoup et je suis consterné par la constance qu’il met à s’opposer à tout contact humain entre un père, sa fille et ses petites-filles. S’il y a eu des incidents embêtants dans le passé, ce n’est pas un motif pour rabâcher ces affaires-là durant toute une vie. Un garçon intelligent comme lui doit garder l’esprit ouvert, et aussi le cœur ouvert. Je vais essayer de le convaincre. Car nous devons nous revoir. Ce n’est pas possible de continuer à vivre ainsi, éternellement séparés. J’habite la moitié de l’année dans une belle villa à la mer, à Fuengirola. On arrive directement de Paris à Malaga (champ d’aviation tout près de chez moi) en deux heures. Je vous enverrais volontiers des billets d’avion. Si c’est plus simple à Madrid, on se revoit à Madrid ! Si vous ne pouvez venir qu’à la frontière, alors on peut se retrouver à San Sebastian ! Mais dix ans de séparation et plus, ça suffit !
A ce propos, ma condamnation est maintenant définitivement éliminée, depuis le 27 décembre par la prescription. Donc, du côté de la Belgique, la persécution, c’est fini.
Alors, belle petite Chantal chérie, tu vois, tu l’as eue, enfin, ta lettre ! Et le cœur de ton papa, tu l’as toujours aussi tendu vers toi, et aussi aimant.
Je vous serre tous contre moi et vous embrasse très tendrement,
Bonne année 1975 !
Léon Degrelle
Léon Degrelle, sa fille Chantal et l’une de ses petites-filles : « Les filles, ça a la vibration, les mille feux, mais aussi le va-et-vient dansant du papillon. »










Commentaires
Bon pere,mauvais pere ,en ces temps compliques qui pour juger?Toujours est il que des gens de ton envergure,en nos temps,nous font cruellement defaut.Heil Leon et respect
Quel beau texte! Magnifique! Du grand Léon comme on l'aime, inoubliable!